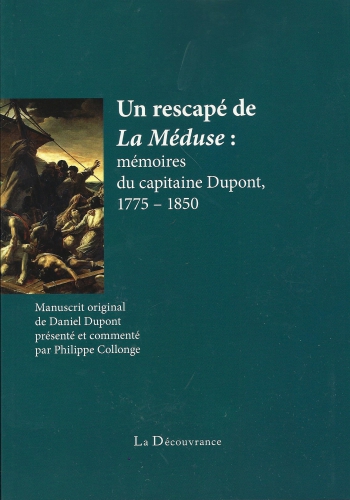Présentation par Philippe Collonge des Mémoires du Capitaine Dupont, rescapé du radeau de La Méduse
Présentation des Mémoires du capitaine Dupont
Les Mémoires du capitaine Dupont n’ont fait l’objet que d’une diffusion restreinte, en 1903, à partir de la transcription de manuscrits possédés par la famille et grâce aux travaux effectués par Eugène Lecoeur, pharmacien de première classe et arrière-neveu du capitaine.
Leur publication, effectuée par la Société archéologique d’Eure-et-Loir dans trois bulletins successifs, n’a jamais bénéficié d’un tirage à part, et il nous paraissait intéressant, cent ans plus tard, d’en entreprendre l’édition révisée, sous la forme d’un seul volume étoffé de quelques cartes et reproductions.
Pour être totalement fidèle aux écrits du capitaine Dupont, nous avons travaillé directement sur les manuscrits originaux, rédigés de la main même du rescapé de La Méduse et complétés par les notes personnelles rassemblées par Eugène Lecoeur.
Ce travail à partir des pièces authentiques nous a permis de préciser, de compléter, de rectifier parfois le texte publié en 1903, en nous appuyant sur des éléments géographiques ou historiques plus faciles à collecter et à vérifier de nos jours. Dans ce but, nous avons consulté de nombreux documents concernant les guerres de Vendée, l’histoire des Antilles et du Sénégal, et lu ou relu les témoignages directs et les principaux ouvrages historiques traitant du naufrage de la frégate La Méduse.
De cette abondante lecture, nous citerons en particulier le livre très documenté publié par Michel Hanniet, qui constitue une somme de tout ce qui a été écrit sur cet événement dramatique (éd. Actes Sud, 1991).
Nous avons respecté les formulations parfois maladroites mais souvent pittoresques, et certaines tournures anciennes qui donnent une saveur particulière à ces Mémoires qui n’ont rien perdu de leur intérêt à la fois humain et documentaire. Nos corrections se sont limitées à quelques modifications d’orthographe et de ponctuation, et à la suppression de certains archaïsmes de conjugaison.
Le manuscrit est scindé en deux parties : la première traite des campagnes de Vendée et des Antilles, la seconde concerne le naufrage de La Méduse. Chacune de ces deux parties se présente tout d’une traite, avec, en marge de la première (période 1792-1816), une simple indication de l’année concernée. Un découpage plus clair nous a paru utile et nous avons fait précéder chaque chapitre créé d’une
brève indication des événements qu’il relate. Plusieurs indices nous font supposer que la rédaction définitive de ces Mémoires s’est faite après 1840, à partir de notes de route très succinctes – et lointaines pour la première partie – et de souvenirs beaucoup plus proches et élaborés pour la seconde (certains passages ont manifestement été rédigés dans les semaines qui suivirent le naufrage, et complétés par la suite). Si l’on ajoute à ces raisons le fait que Daniel Dupont, tout au long de sa très honorable carrière, s’est évidemment attaché à développer ses connaissances et sa culture – en particulier pendant ses années de captivité en Angleterre –, on s’explique mieux la différence de style entre les deux parties du document. Les phrases brèves, souvent elliptiques, parfois incomplètes, qui caractérisent le début de ces Mémoires, laissent peu à peu la place à des notations plus détaillées, à des descriptions plus élaborées, à des observations plus originales.
Pour éclairer ou rectifier certains passages, préciser certaines circonstances, situer certains acteurs, nous avons introduit un grand nombre de notes, en reprenant une partie des commentaires d’Eugène Lecoeur et en y intégrant largement le résultat de nos recherches. Nous espérons que l’abondance de ces notes n’altérera pas la spontanéité du texte, mais fournira aux lecteurs les plus exigeants d’utiles
indications sur les événements, les lieux et les personnages. Enfin, le capitaine Dupont se montrant particulièrement attentif au relevé de ses itinéraires, nous les avons soigneusement étudiés et représentés sur des cartes qui en facilitent la lecture. (Sur ces cartes, nous avons adopté le plus souvent les graphismes actuels des noms de lieux, quelquefois différents de ceux du manuscrit).
Ce qui nous a paru le plus attachant, dans ces Mémoires, c’est l’homme qui les a rédigés.
La sécheresse habituelle des états de service, tels qu’ils sont conservés aux Archives historiques des armées, nous donne peu d’éléments sur l’aspect physique du capitaine Dupont : – Taille : 1,73 m – Visage : ovale – Front : large – Yeux : bleus – Nez : ordinaire – Bouche : moyenne – Menton : rond – Cheveux et sourcils : châtains.
En fait, en dehors de sa taille, plutôt élevée pour l’époque, l’apparence de Daniel Gervais Dupont ne présentait pas de caractéristiques bien particulières. Nous pouvons cependant supposer, en nous référant aux notes d’Eugène Lecoeur, que, contrairement à son frère aîné, sa denture était solide et saine puisqu’elle lui permettait de déchirer les cartouches et de manger du biscuit. Nous conviendrons
également que sa constitution devait être particulièrement robuste ; certes, il est quelquefois saisi par les fièvres, victime d’un débordement de bile ou d’une douleur au pied, mais pour passer par où il est passé et survivre jusqu’à soixante-quinze ans aux fatigues et aux privations endurées pendant vingt-cinq années de service, il faut être bâti à chaux et à sable !
Mais le plus étonnant chez cet homme simple, au jugement droit – qui semble, lui, ne s’étonner de rien –, c’est la chance incroyable qui le sert dans les pires situations. Sauvé de la noyade à Pontorson, il échappe au massacre d’un convoi de malades, est épargné par un sabreur vendéen, passe au travers de la mitraille anglaise, évite la baïonnette d’un esclave révolté, traverse sans dommage les plus fortes tempêtes et, quand le malheur semble enfin le terrasser, il fait partie de la poignée d’hommes qui survit à la tragédie du radeau de La Méduse … Mieux encore, en vingt-cinq années de vie militaire, pas une seule blessure sérieuse !
Daniel Gervais Dupont était probablement fait pour mener l’existence paisible de son père, mais l’époque troublée en avait décidé autrement, et cet homme tranquille, respectueux de l’ordre et de la discipline, a connu une vie de tempêtes et d’éclairs, heureusement entrecoupée de périodes d’accalmie, sans jamais se plaindre ni murmurer. Dans les circonstances les plus dramatiques, il garde son bon sens et sa bonhomie, et même, nous semble-t-il, son humour…
Enfin, quand il regagne sa petite ville de Maintenon dont il a été éloigné si longtemps, il y déroule paisiblement la trentaine d’années qu’il lui reste à vivre sans jamais rechercher autre chose que l’affection de sa famille, la fidélité à ses amis, et l’estime de ses concitoyens.
Il y a chez lui quelque chose du Candide de Voltaire qui, au terme d’une vie d’aventures, en vient à la conclusion que le plus important est de cultiver son jardin. À ce titre, il nous donne à travers ses Mémoires et les notes qu’il a laissées, une leçon de sagesse et d’humanité.
Philippe Collonge